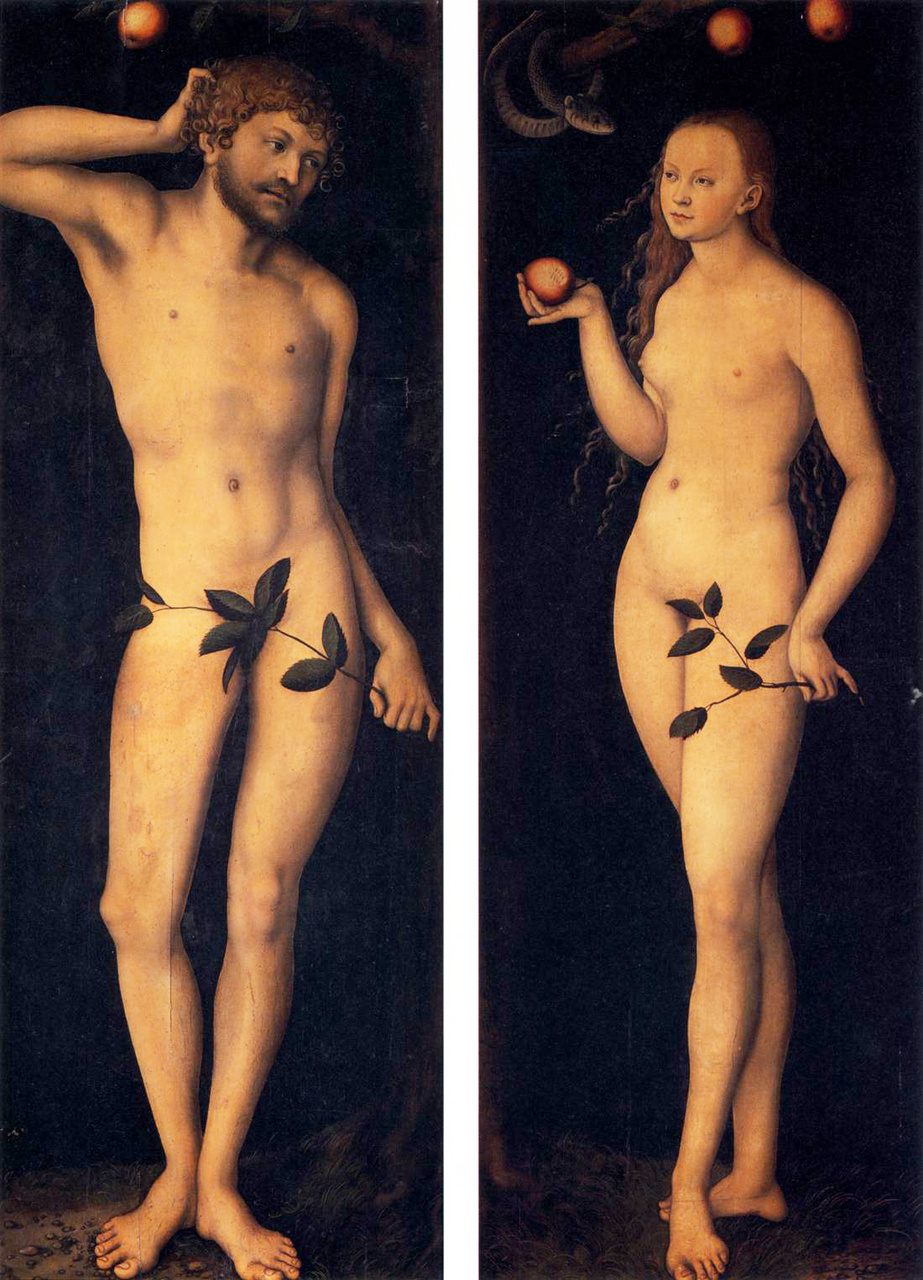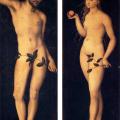Depuis Aristote (Histoire des animaux), la dichotomie physiologique homme/femme est bien assumée par tous les naturalistes, puis les anatomistes, les physiologistes, et encore maintenant par de nombreux médecins. Le problème a été très clairement posé dans un article retentissant publié dans le Journal of Law, Medicine & Ethics en 2001 intitulé « La fille qui criait de douleur : un préjugé contre les femmes dans le traitement de la douleur ».1
Asymétrie homme/femme vis-à-vis de la douleur
La multiplication des études statistiques a mis en évidence, de façon interculturelle, une nette asymétrie homme/femme vis-à-vis de la douleur, mais variable selon les populations et selon les sites anatomiques (rien n’est donc absolument systématique) : chez les femmes, moindre fréquence de symptômes thoraciques en cas d’infarctus myocardique,2 douleurs dorsales plus fréquentes et importantes,3 migraines deux à trois fois plus fréquentes que chez les hommes (mais aussi de durée plus longue, avec risque augmenté de récidive, plus grande invalidité et temps de récupération accru),4 douleurs chroniques plus sévères après thoracotomie avec consommation plus importante d’analgésiques,5 douleurs plus marquées que chez les hommes après chirurgie cardiaque,6 etc.
Dans le même temps, une notion classique (et misogyne ?) de moindre ressenti de la douleur chez les femmes amène symétriquement à une moindre prise en charge de celles-ci, comme dans le cadre des douleurs abdominales où, pour un score moyen de douleur similaire, les hommes reçoivent une oligo-analgésie aux opiacés plus fréquemment que les femmes.7 Il en est de même pour une analgésie en contexte de blessures isolées des extrémités en milieu préhospitalier.8
En réalité, il y a surtout une fluctuation du ressenti de la douleur peut-être plus importante chez les femmes, telle que récemment décrite dans une étude canadienne : dans celle-ci, les femmes signalaient plus de douleur que les hommes au début de la première exposition à la douleur mais ressentaient ensuite moins de douleur et de gêne que les hommes à mesure qu’un stimulus douloureux était maintenu et avec une stimulation répétée. Les schémas d’atténuation de la douleur et de la gêne chez les femmes ressemblaient à l’atténuation des sensations aiguës, de picotement et de coupure, tandis que les schémas de douleur et de gêne chez les hommes s’apparentaient à des sensations de brûlure. Prises ensemble, ces données démontreraient une dichotomie sexuelle dans l’évolution temporelle de la douleur : seules les femmes présenteraient une adaptation et une accoutumance qui leur permettraient de ressentir moins de douleur au fil du temps.9
Rôle des constructions sociales et culturelles
Le rôle des hormones sexuelles (œstrogènes et progestérone) a bien évidemment été incriminé en premier, de même qu’une expression phénotypique différente vis-à-vis des récepteurs nociceptifs. Mais cette implication de facteurs hormonaux et physiologiques apparaît, dans plusieurs méta-analyses, soit incohérente, soit absente : la sommation temporelle, l’allodynie et l’hyperalgésie secondaire pourraient être plus prononcées chez les femmes que chez les hommes ; quant aux preuves de systèmes inhibiteurs endogènes de la douleur moins efficaces chez les femmes, elles sont mitigées et ne s’appliquent pas nécessairement à toutes les modalités.10
Mais ces facteurs n’expliquent pas tout et sont probablement très marginaux. Des constructions sociales et culturelles (stéréotypes de genres, sexisme) semblent jouer un rôle prépondérant dans le ressenti individuel, la projection vis-à-vis du soignant (surtout de sexe opposé) et la prise en charge qui en découle.11 - 13
Quelle explication physiologique ?
L’influence du sexe a été négligée dans les études cliniques sur la douleur et l’analgésie, la grande majorité des recherches ayant été menées exclusivement sur des hommes. Cependant, les études précliniques et cliniques indiquent que les hommes et les femmes diffèreraient dans la composition anatomique et physiologique des circuits du système nerveux central impliqués dans le traitement de la douleur et l’analgésie (dimorphisme neuro-anatomique et neuropathologique, principalement au niveau du circuit modulateur descendant endogène de la douleur). Ces différences influenceraient non seulement la réponse aux stimuli nocifs mais aussi la capacité des agents pharmacologiques à modifier cette réponse. La morphine est l’opiacé le plus largement prescrit pour le soulagement de la douleur persistante en clinique ; cependant, il devient de plus en plus évident que la morphine est moins puissante chez les femmes que chez les hommes.14
Vis-à-vis de stimuli somatiques administrés expérimentalement, les femmes ont des seuils de tolérance plus bas, une plus grande capacité de discrimination, des scores de douleur plus élevés et une tolérance moindre aux stimuli nociceptifs que les hommes. Ces différences sont toutefois minimes, n’existent que pour certaines formes de stimulation et sont affectées par de nombreuses variables situationnelles tels une comorbidité, le cadre expérimental et l’état nutritionnel. Pour les douleurs endogènes, les femmes signalent davantage de douleurs multiples dans de plus nombreuses régions du corps que les hommes.
Une explication de cette dichotomie pourrait être anatomique : le canal vaginal constituerait chez les femmes une voie supplémentaire de traumatisme interne et d’invasion par des agents pathologiques qui les exposeraient à un risque plus élevé de développer une hyperalgésie dans de multiples régions du corps. En outre, les différences entre les sexes dans les schémas temporels sont susceptibles de donner lieu à une dichotomie dans la façon dont la douleur est « apprise » et les stimuli sont interprétés. Enfin, les différences entre les sexes dans l’action des hormones sexuelles suggèrent des différences dans le fonctionnement de nombreux agents neuro-actifs, des systèmes opiacés et non opiacés, des facteurs de croissance nerveuse et du système sympathique.16
Tenir compte du genre dans la prise en charge de la douleur
Si les résultats des études scientifiques divergent significativement, la tendance générale d’une dichotomie homme/femme dans le ressenti et le soin de la douleur semble exister, mais d’importance variable. Les femmes ressentent une douleur nettement différente de celle des hommes et ont probablement besoin de nouveaux schémas analgésiques et/ou multimodaux pour améliorer leur confort, diminuer leur symptomatologie mais aussi accélérer leur récupération. Une adaptation des soins, et notamment une prise en charge adaptée de la douleur, en tenant compte du genre du patient et se fondant sur les études anthropologiques médicales préalables, doit devenir une priorité de santé publique.
2. Lovlien M, Schei B, Hole T. Women with myocardial infarction are less likely than men to experience chest symptoms. Scand Cardiovasc J 2006;40(6):342-7.
3. Schneider S, Randoll D, Buchner M. Why do women have back pain more than men? A representative prevalence study in the federal republic of Germany. Clin J Pain 2006;22(8):738-47.
4. Vetvik KG, MacGregor EA. Sex differences in the epidemiology, clinical features, and pathophysiology of migraine. Lancet Neurol 2017;16(1):76-87.
5. Ochroch EA, Gooschalk A, Troxel AB, et al. Women suffer more short and long-term pain than men after major thoracotomy. Clin J Pain 2006;22(5):491-8.
6. Bjornnes AK, Parry M, Lie I, et al. Pain experiences of men and women after cardiac surgery. J Clin Nurs 2016;25(19-20):3058-68.
7. Chen EH, Shofer FS, Dean AJ, et al. Gender disparity in analgesic treatment of emergency department patients with acute abdominal pain. Acad Emerg Med 2008;15(5):414-8.
8. Michael GE, Sporer KA, Youngblood GM. Women are less likely than men to receive prehospital analgesia for isolated extremity injuries. Am J Emerg Med 2007;25(8):901-6.
9. Hashmi JA, Davis KD. Women experience greater heat pain adaptation and habituation than men. Pain 2009;145(3):350-7.
10. Racine M, Tousignant-Laflamme Y, Kloda LA, et al. A systematic literature review of 10 years of research on sex/gender and pain perception - part 2: do bio psychosocial factors alter pain sensitivity differently in women and men? Pain 2012;153(3):619-35.
11. Alabas OA, Tashani OA, Tabasam G, et al. Gender role affects experimental pain responses: A systematic review with meta-analysis. Eur J Pain 2012;16(9):1211-3.
12. Graf J, Simoes E, Kranz A, et al. The importance of gender-sensitive health care in the context of pain, emergency and vaccination: A narrative review. Int J Environ Res Public Health 2023;21(1):13.
13. Kolmes SK, Boerstler KR. Is there a gender self-advocacy gap? An empiric investigation into the gender pain gap. J Bioeth Inq 2020;17(3):383-93.
14. Lloyd DR, Murphy AZ. The neuroanatomy of sexual dimorphism in opioid analgesia. Exp Neurol 2014;259:57-63.
15. Berkley KJ. Sex differences in pain. Behav Brain Sci 1997;20(3):371-80.
Une question, un commentaire ?