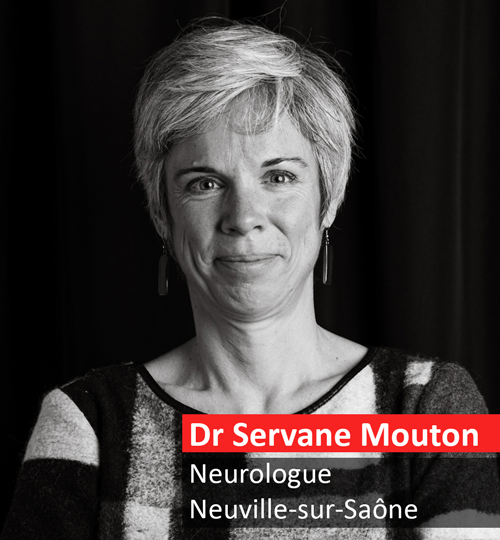Dans votre rapport « Enfants et écrans », vous plaidez pour le « zéro écrans » avant 3 ans. Quels sont leurs effets prouvés sur cette tranche d’âge ?
L’exposition aux écrans – tous types confondus – avant 3 ans est associée à de moins bonnes performances sur le plan du langage, des capacités attentionnelles et sociorelationnelles et de la régulation des émotions. Il n'y a pas de bénéfice, mais uniquement des risques. Par ailleurs, avant 3 ans, les enfants ont un « déficit de transfert vidéo », c'est-à-dire qu'ils apprennent moins bien à travers un écran – même s’il s’agit de contenus « éducatifs » – que via une interaction humaine directe. Mettons de côté les enfants ayant des besoins éducatifs particuliers, par exemple ceux souffrant de TSA, qui pourraient tirer profit de certaines applications dédiées, dans des indications très encadrées par des psychiatres ou des pédiatres.
Suivant vos recos, un arrêté du 2 juillet 2025 a interdit les écrans dans les lieux d’accueil des jeunes enfants. Catherine Vautrin, ex-ministre de la Santé, comptait élargir cette interdiction « partout, y compris à la maison ». Qu’en pensez-vous ?
Dans un espace public en collectivité, comme un lieu d’accueil des jeunes enfants, le contrôle est institutionnel : il y a donc une réglementation, d’où l’arrêté qui a été posé. Avec une interdiction plus large, évidemment, on ne va pas aller regarder ce qui se passe dans chaque famille. La réglementation aurait un caractère symbolique, qui acte que les écrans ne conviennent pas aux tout-petits. C’est un peu du même ordre que la loi qui interdit la fessée. Cette prohibition a changé la perception que la société a de ce geste : elle participe ainsi à modifier les comportements, sans impliquer, évidemment, un contrôle policier derrière chaque parent. Pour limiter l’exposition aux écrans des tout-petits, la principale difficulté est d’arriver à informer de manière ciblée et adaptée tous les publics, notamment les familles difficiles à atteindre (par exemple dans les milieux socioéconomiques défavorisés).
De 3 à 6 ans, quels sont les repères, et sur quels résultats scientifiques se fondent-ils ?
Dans la littérature scientifique, majoritairement anglosaxonne sur ce sujet, on distingue plutôt les moins de 2 ans des enfants de 2 à 5 ans, ou « préscolaires ». Les dernières guidelines de l’OMS pour ces derniers datent de 2019, et indiquent 1 h max d’écran par jour, mais « moins, c’est mieux », sans fixer de durée « sûre ». Depuis, de nouvelles publications1 - 3 sont parues concernant les 4 à 6 ans, et indiquent un effet délétère sur le neurodéveloppement dès de faibles temps d’exposition quotidienne. Par exemple, la cohorte française Elfe trouve, chez les 3 à 6 ans, une association avec de moindres performances cognitives globales, en particulier au niveau du langage, et ce dès 30 min d’exposition par jour.
De plus, les recos doivent prendre en considération, outre ces études épidémiologiques, les observations de terrain des enseignants, parents, soignants, les études expérimentales et d’intervention, ainsi que les effets sur la vision (myopie notamment, cf. encadré 1) et les rythmes circadiens. Concernant les usages dits « éducatifs », ils nous paraissent peu pertinents, du fait des effets potentiellement délétères sur l’œil et sur les rythmes circadiens, mais aussi parce qu’on sait l’importance de l’approche multisensorielle pour les apprentissages.
Pris dans leur ensemble, ces éléments nous conduisent à formuler que les activités sur écran ne conviennent pas aux moins de 6 ans (cf. ce texte cosigné par 5 sociétés savantes).
De 6 à 18 ans, quels sont les risques des écrans ?
Le neurodéveloppement se poursuit jusqu’à l’âge de 25 ans, avec structuration et maturation des réseaux sous-tendant toutes les fonctions cognitives telles que le langage, les fonctions exécutives, l’attention, la mémoire mais aussi les compétences sociorelationnelles, la métacognition (le fait d'analyser nos propres pensées) ou encore l'empathie. Ce neurodéveloppement est sous la forte influence de l’environnement, où les écrans sont des éléments très présents. À ma connaissance, il n'y a pas eu de travail collégial qui permettrait de dire, « de tel âge à tel âge, on peut s’exposer sans risques à tant de temps d'écrans et à tel type de contenu ». C'est un travail nécessaire et qui devrait prendre en compte tous les enjeux – à la façon des « 24 -h movement guidelines » formulées par plusieurs pays comme le Canada –, avec la nécessité d'avoir à côté des écrans tout un panel d'activités variées concourant à une bonne santé physique et mentale, et favorables au neurodéveloppement (lecture, jeu libre, activités culturelles, interactions sociales et affectives, activités physiques, limitation de la sédentarité, temps passé à l’extérieur, préservation du sommeil, etc.).
Cela étant, on observe une association entre un temps d’écran élevé et de moindres capacités attentionnelles4 - 6 et performances scolaires7. Par ailleurs, s’il manque des données probantes pour définir le temps de sédentarité acceptable, la limite de 2 heures/jour (hors temps scolaire) est souvent retenue pour les 5 à 18 ans (cf. rapport de l’ANSES de 2020 ). C’est une durée bien inférieure aux temps d'écran récréatifs moyens des 15 - 17 ans, qui dépassent aujourd’hui 5 h/j ! Mais 2 h à 6 ans ou à 17 ans, ce n’est évidemment pas pareil ; il faudrait affiner...
Que sait-on de l’impact des écrans sur la santé mentale des adolescents ?
On observe une dégradation de la santé mentale des 10 - 25 ans depuis une dizaine d'années. Même si ce n'est pas la seule cause, les réseaux sociaux y contribuent très probablement. Si la pandémie du covid a joué un rôle, cette altération de la santé mentale était constatée avant et elle persiste avec une augmentation des idées suicidaires, des troubles dépressifs… Les réseaux sociaux sont pointés du doigt du fait du risque d’enfermement dans des « bulles de filtre » liées aux algorithmes de recommandation, entraînant certains usagers dans une spirale descendante en amplifiant des contenus anxiogènes ou morbides. De fait, il existe une association entre troubles de la santé mentale et usage des réseaux sociaux8,9 chez les ados et les pré-ados. La causalité n’est pas démontrée, mais tout un faisceau d’arguments vont dans ce sens, notamment pour certains troubles : troubles du comportement alimentaire, idées ou actes d’automutilation ou de suicide, cyberharcèlement. De plus, les réseaux sociaux utilisés le soir (dans l’heure précédent le coucher) ou la nuit favorisent anxiété et dépression via l’altération qualitative et quantitative du sommeil.
Quels messages le MG peut donner aux parents et aux enfants ?
Attention, il ne s’agit pas de culpabiliser les parents : nous savons que chacun fait au mieux, avec ses moyens, et dans des conditions parfois extrêmement difficiles, dont il faut tenir compte. Il s’agit d’informer, d’expliquer et d’accompagner chaque situation particulière.
En plus de nos recommandations sur les temps d’écran selon l’âge (cf. encadré 2), l’usage des écrans devrait être systématiquement abordé lors des consultations – même si on sait à quel point le temps peut manquer ! – par des questions adressées régulièrement aux parents, aux enfants et ados vus sans leurs parents. Il faudrait s’intéresser non seulement au temps passé devant les écrans, mais aussi à la manière dont ils sont utilisés.
Enfin, il y a 3 grands messages à faire passer.
D’abord, une des causes majeures du mésusage des écrans, c'est que le modèle économique des principales applications est toxique : basé sur l'économie de l'attention, il induit des usages inappropriés, puisqu’il nous pousse à revenir sur ces applications le plus souvent et le plus longtemps possible. Il faut y sensibiliser les parents et les plus jeunes, leur dire qu’ils sont ciblés à leurs dépens par ces applications, qui cherchent à s’enrichir sans égard pour les conséquences négatives sur leur santé.
Le 2e message, c'est de dire qu’une activité sur écrans peut être intéressante ou divertissante, mais qu’elle doit s’intégrer dans un contexte riche d'autres activités : sport, activités culturelles, interactions avec les pairs et la famille, devoirs, sommeil… Une promenade avec (ou sans) le chien, une séance de chatouilles, se raconter mutuellement sa journée, sont autant d’activités simples, qui répondent aux besoins de l’enfant mieux qu’une vidéo en streaming. S’il reste du temps pour des activités sur écran, pourquoi pas ? Mais il faudrait qu’elles cessent d’être les divertissements incontournables de chaque journée. Les éventuels effets délétères des écrans seront ainsi minimisés, en mettant l’accent sur des activités alternatives et en respectant des balises : pas d'écran avant l'école, pas d'écran dans la chambre à coucher, pas d'écran pendant le repas, arrêt au moins 1 h avant le coucher.
Enfin, le 3e message concerne le rôle fondamental des parents et de leur propre usage des écrans. Par souci d’exemplarité et de cohérence d’abord, mais aussi en raison des conséquences des technoférences, soit les interférences dans la relation parent-enfant induites par l’usage des écrans par le parent en présence de l’enfant. Celles-ci sont associées à de moindres performances cognitives et psychosociales chez l’enfant de moins de 5 ans, ainsi qu’à une moins bonne santé mentale et à plus de troubles du comportement chez les adolescents.
1. Risque de myopie : quel est le rôle des écrans ?
Devant l’épidémie de myopie qu’on constate dans le monde, le rôle des écrans est longtemps resté incertain. Les études récentes, recensées notamment dans plusieurs méta-analyses10,11, concluent presque toutes à un lien significatif entre le temps passé devant des écrans de toutes sortes (tablettes, téléphones, TV, ordinateurs…) et le risque de myopie chez l’enfant et chez l’adolescent, sans qu’on puisse préciser les seuils de sécurité. L'œil de l'enfant est particulièrement vulnérable aux effets de la lumière bleue émise par les écrans jusqu'à l'âge de 13 - 14 ans, encore plus jusqu'à 6 - 8 ans, en raison de la grande transparence du cristallin. Par ailleurs, les activités sur écran ont souvent lieu en intérieur au détriment d'activités en extérieur, alors que l'éclairage à la lumière naturelle est nécessaire pour le bon développement de l'œil : une utilisation excessive d’écrans peut donc aussi favoriser la myopie de manière indirecte.
2. Les recommandations de la commission « Enfants et écrans »
Sur l’exposition aux écrans, tous types confondus :
- avant 3 ans : pas d’exposition aux écrans ;
- jusqu’à 6 ans : usage déconseillé, ou tout au moins fortement limité, occasionnel, avec des contenus à qualité éducative et accompagné par un adulte ;
- après 6 ans : exposition modéré et contrôlée aux écrans.
Le rapport précise que « la Commission se garde, en l’état actuel des connaissances, d’émettre des recommandations en termes de temps d’écran, car le temps d’écran est une variable très imparfaite pour réguler les activités numériques […]. En l’état actuel des connaissances, tout seuil serait nécessairement arbitraire. »
Sur le téléphone portable :
- avant 11 ans (entrée au collège) : pas de téléphone ;
- à partir de 11 ans : si l’enfant a un téléphone, il est recommandé qu’il ne soit pas connecté à internet ;
- à partir de 13 ans : si l’enfant a un téléphone connecté, il est recommandé qu’il ne permette pas d’accéder aux réseaux sociaux ni aux contenus illégaux ;
- à partir de 15 ans (majorité numérique) : l’accès aux réseaux sociaux devrait être limité à ceux conçus de façon éthique, c’est-à-dire sans design manipulateur et/ou trompeur, (les réseaux sociaux populaires et massivement fréquentés actuellement ne répondent pas à cette exigence, NDLR).
2. Madigan S, Browne D, Racine N, et al. Association Between Screen Time and Children's Performance on a Developmental Screening. JAMA Pediatr 2019;173(3):244-50.
3. Yang S, Saïd M, Peyre H et al. Associations of screen use with cognitive development in early childhood: the ELFE birth cohort. J Child Psychol Psychiatr 2024;65(5):680-93.
4. Eirich R, McArthur BA, Anhorn C, et al. Association of Screen Time With Internalizing and Externalizing Behavior Problems in Children 12 Years or Younger: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Psychiatr 2022;79(5):393-405.
5. Thorell LB, Burén J, Ström Wiman J, et al. Longitudinal associations between digital media use and ADHD symptoms in children and adolescents: a systematic literature review. Eur Child Adolesc Psychiatr 2022;33(8):2503-26.
6. Paulich KN, Ross JM, Lessem JM, et al. Screen time and early adolescent mental health, academic, and social outcomes in 9- and 10- year old children: Utilizing the Adolescent Brain Cognitive Development ℠ (ABCD) Study. PLoS One 2021;16(9):e0256591.
7. Bao R, Qin H, Memon AR et al. Is adherence to the 24-h movement guidelines associated with greater academic-related outcomes in children and adolescents? A systematic review and meta-analysis Eur J Pediatr 2024;183(5):2003-14.
8. Liu M, Kamper-DeMarco KE, Zhang J, et al. Time Spent on Social Media and Risk of Depression in Adolescents: A Dose–Response Meta-Analysis. Int J Environ Res Public Health 2022;19(9):5164.
9. Fassi L, Thomas K, Parry DA, et al. Social Media Use and Internalizing Symptoms in Clinical and Community Adolescent Samples: A Systematic Review and Meta-Analysis. JAMA Pediatr 2024;178(8):814-22.
10. Ha A, Lee YJ, Lee M, et al. Digital Screen Time and MyopiaA Systematic Review and Dose-Response Meta-Analysis. JAMA Netw Open 2025;8(2).
11. Zong Z, Zhang Y, Qiao J, et al. The association between screen time exposure and myopia in children and adolescents: a meta-analysis. BMC Public Health 2024;1625 (2024).
Pour en savoir plus :
Rapport « Enfants et écrans. À la recherche du temps perdu ». Avril 2024.
Légifrance. Arrêté du 27 juin 2025 modifiant la charte nationale pour l'accueil du jeune enfant. 27 juin 2025.