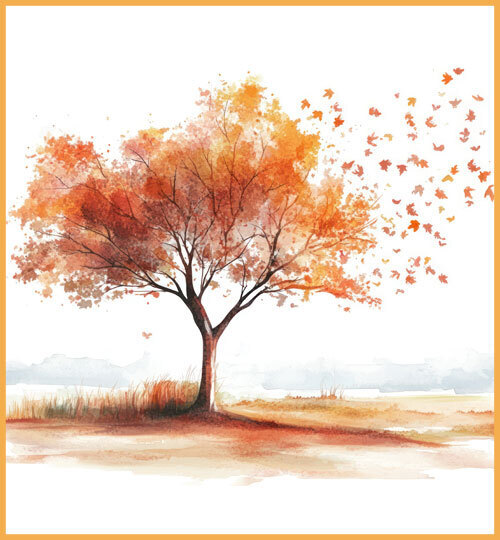Critères diagnostiques : stades de la maladie d’Alzheimer
À ce jour, il existe plusieurs propositions de critères pour diagnostiquer la maladie d’Alzheimer. Le groupe de travail propose d’utiliser les stades cliniques symptomatiques tels que définis récemment par l’Alzheimer Association Working Group (encadré). Cependant, certaines situations cliniques peuvent amener à une surestimation du déficit cognitif, en cas d’atteinte langagière au premier plan par exemple, ou une sous-estimation du déficit cognitif en cas d’atteinte dysexécutive au premier plan. L’interrogatoire d’un proche ou aidant passant au moins plusieurs heures par semaine aux côtés du patient est donc particulièrement important. L’évaluation du stade clinique évolutif peut être complexe dans les stades débutants et nécessite l’expertise de médecins formés à la consultation mémoire.
Que faire devant une plainte cognitive en MG ?
Le groupe de travail recommande de prendre en compte toute plainte, gêne ou modification cognitive et d’objectiver un éventuel déficit cognitif en considérant l’âge, le sexe et le niveau socioculturel du patient. La plainte peut concerner la mémoire, l’orientation temporelle ou spatiale, le langage, les fonctions exécutives ou attentionnelles, le calcul, les praxies, les gnosies, la vision, la cognition sociale (moins d’affects vis-à-vis d’événements importants négatifs ou positifs, perte d’empathie, négligence de son apparence ou de son hygiène, difficultés pour respecter les règles du vivre ensemble, moindre retenue dans les interactions ou dans les propos tenus).
Elle peut être associée à d’autres symptômes, notamment des troubles du sommeil, alimentaires, psycho-comportementaux, psychotiques (ex : hallucinations), troubles neurovégétatifs, fluctuations ou symptômes moteurs (chutes, troubles de l’équilibre, de la marche, lenteur gestuelle, mouvements anormaux).
Une plainte cognitive est considérée comme suspecte lorsqu’elle a certaines caractéristiques pouvant indiquer un trouble neurocognitif mineur ou majeur, notamment : lorsqu’elle est corroborée par l’entourage ; associe des troubles dans plusieurs modalités cognitives ou comportementales ; ou est associée à un retentissement fonctionnel. L’aggravation de la plainte sur plusieurs mois ou années est un élément important supplémentaire. Une plainte cognitive suspecte nécessite alors une évaluation objective plus ou moins approfondie en fonction du contexte, afin d’identifier une éventuelle cause neurodégénérative.
L’utilisation de questionnaires validés courts peut aider à évaluer la plainte cognitive, comme le questionnaire de plainte cognitive (QPC) ou le questionnaire AD8.
Quels outils utiliser pour repérer un trouble neurocognitif en soins primaires ?
L’identification et le repérage d’un trouble cognitif sont souvent réalisés en médecine générale. Néanmoins, a l’inverse de plusieurs autres pays comme le Royaume-Uni, les États-Unis ou l’Allemagne, la France ne dispose pas de recommandations pour l’usage d’un outil ou d’une combinaison d’outils de repérage en MG (le guide HAS ne met en avant aucun test particulier).
Le groupe de travail recommande les outils suivants :
- Score MMSE (indispensable) : évaluant l’efficience cognitive globale, il s’est imposé comme le test cognitif minimal pour caractériser l’état cognitif du patient, et participe au suivi cognitif ultérieur. Sa durée de réalisation est le plus souvent inférieure a 15 min, ce qui le rend utilisable en soins primaires. Ce test a toutefois des limites, qu’il faut connaître : sur le plan mnésique, il ne vérifie pas l’encodage des mots et surtout ne permet absolument pas d’évaluer les fonctions exécutives des patients. Par ailleurs, il ne permet en rien de poser un diagnostic étiologique.
- Mini-IADL (indispensable) à 4 items (téléphone, transport, budget, gestion des médicaments) : pour caractériser le retentissement sur les fonctions instrumentales de la vie quotidienne.
- Un test de mémoire épisodique verbale (si possible) : test des 5 mots de Dubois ou Memory Impairment Screen (MIS). Utile en cas de plainte mnésique, il évalue la mémoire épisodique verbale en mesurant l’apprentissage et le rappel de 5 mots appartenant à des catégories sémantiques différentes. Il permet l’apprentissage des mots au moyen d’un indiçage catégoriel initial. Ainsi, il est possible de différencier l’atteinte des différents processus d’encodage, de récupération et de stockage.
- Test de l’horloge (si possible). Le test de l’horloge est simple, rapide, et a des propriétés psychométriques pertinentes pour le repérage des troubles cognitifs en soins primaires. Il est demandé au patient de dessiner une horloge, de placer les chiffres et enfin les aiguilles en indiquant une heure précise (11 h 10, par exemple). Il est parfois difficile de l’interpréter, et de nombreuses cotations ont été publiées (intégrité du cadran, présence et séquençage des chiffres, présence et placement des aiguilles). Ce test ne permet pas de distinguer précisément la fonction cognitive altérée.
Par ailleurs, des outils numériques accessibles sur tablette ou smartphone ont été développés par des équipes françaises :
- ICOPE Monitor visant à une évaluation et surveillance globale de la capacité intrinsèque des personnes âgées de 60 ans et plus ;
- MemScreen et « Santé-Cerveau Digital Tool » (SCD-T) permettant une évaluation automatisée de la mémoire épisodique verbale et de l’efficience cognitive globale.
Un programme de recherche est en cours dans plusieurs villes en France pour évaluer la pertinence de recourir à la combinaison de l’impression clinique du médecin généraliste, associée aux échelles GP-Cog (partie 2 d’évaluation fonctionnelle) et 6 -CIT en médecine générale pour le repérage de troubles cognitifs aux stades mineur et majeur (étude Trocomege).
En soins primaires, quel bilan paraclinique réaliser en première intention face à une suspicion de trouble neurocognitif ?
En cas de déficit neurocognitif objectivé, il convient d’écarter certains diagnostics différentiels curables ou maladies non-neurodégénératives fréquentes. Pour cela, la réalisation d’un bilan minimal comportant des analyses biologiques et une imagerie cérébrale est nécessaire, selon les recommandations de la HAS.
La réalisation d’un bilan de première intention est recommandée et devrait comporter :
- Bilan biologique :
- NFS, CRP, ionogramme sanguin incluant natrémie, calcémie, glycémie, albuminémie, urée, créatinine, TSH ;
- en fonction du contexte clinique ou systématiquement chez le sujet jeune (âge de début < 65 ans) : vitamine B12, folates, bilan hépatique, sérologies Lyme, VIH, syphilis ;
- si ces examens biologiques ont été pratiqués il y a moins de 6 mois dans le cadre du suivi, il est inutile de les prescrire de nouveau.
- Imagerie morphologique : une IRM cérébrale est systématique et devrait comporter notamment une séquence T1 volumétrique, une séquence FLAIR, une séquence sensible aux saignements (T2* ou T2EG, SWI ou SWAN). Une injection de produit de contraste n’est pas nécessaire en première intention. Le scanner cérébral est à réserver aux contre-indications de l’IRM : claustrophobie, matériel étranger non compatible avec l’IRM, agitation du patient. Le but de cet examen est :
- de ne pas méconnaître l’existence d’une autre cause (processus expansif intracrânien, pathologie inflammatoire du système nerveux central, hydrocéphalie chronique de l’adulte, séquelle d’accident vasculaire, hématome sous-dural…) ;
- d’objectiver des lésions vasculaires (hypersignaux de substance blanche en lien avec une microangiopathie vasculaire quantifiée selon la classification de Fazekas, microsaignements) ;
- d’objectiver et, le cas échéant, de quantifier une éventuelle atrophie corticale diffuse ou focale, notamment hippocampique (score de Scheltens) et/ou lobaire.
Comment orienter un patient suspect de trouble neurocognitif ?
Une consultation avec un médecin formé à la consultation mémoire doit être proposée afin de réaliser un diagnostic étiologique, en présentiel (ou à défaut par le biais d’une téléexpertise), dans les situations suivantes :
- patient ayant un trouble neurocognitif documenté par un médecin généraliste ;
- inquiétude ou demandes répétées de l’entourage.
Un avis spécialisé en consultation mémoire labellisée doit être plus particulièrement sollicité dans les cas suivants :
- patient dont les signes débutent avant l’âge de 65 ans, ou encore en activité ;
- histoire ou antécédents familiaux au premier degré ;
- doute diagnostique (troubles de la mémoire associés d’emblée a des signes neurologiques ou psychiatriques) ou forme non amnésique ;
- patient nécessitant une prise en soin immédiate (trouble grave du comportement, risque pour la sécurité, problématique médico-légale).
Dans certains cas, il sera préférable d’adresser le patient a une équipe spécifique :
- les patients dont les troubles ont débuté avant l’âge de 65 ans ou appartenant à une famille avec forme monogénique de maladie d’Alzheimer doivent préférentiellement être adressés aux Centres mémoire de ressources et de recherche (CMRR) ;
- les patients souhaitant participer à un protocole de recherche thérapeutique ou ayant des formes différentes de la forme typique (amnésique) doivent être prioritairement adressés aux CMRR ou aux « consultations mémoire » de territoire ;
- un patient âgé de plus de 75 ans, polypathologique ou ayant une altération de l’état général, sera préférentiellement orienté en hôpital de jour (HDJ) pour regrouper les examens et assurer une évaluation plus globale de la situation.
Un patient n’ayant pas de comorbidités ou en bon état général peut réaliser les examens en ambulatoire, en ville ou à l’hôpital.
Diagnostic précoce : enjeux et limites
Bien que son intérêt soit controversé en raison de l’absence de traitement curatif, le diagnostic précoce offre plusieurs avantages selon ces experts : il permet un accès précoce à des interventions médicales et psychosociales adaptées, de planifier les soins à long terme, d’allouer les ressources et de mieux anticiper les besoins futurs en matière de soins de santé et de soutien communautaire.
En 2007, le groupe de travail International Working Group (IWG) a introduit un nouveau concept définissant la maladie d’Alzheimer « prédementielle » ou prodromique. Le diagnostic à ce stade précoce se fonde sur des critères clinico-biologiques, nécessitant à la fois la mise en évidence de performances cognitives anormales lors d’un bilan neuropsychologique (par un médecin formé à la consultation mémoire) et la positivité de biomarqueurs objectivant à la fois une anomalie du peptide bêta-amyloïde (diminution du peptide Aβ42 ou du ratio Aβ42/40 dans le LCS ou TEP amyloïde positive) et de la protéine tau phosphorylée (dans le LCS ou en 2e intention TEP-tau anormale). La décision du dosage de ces biomarqueurs doit toutefois résulter du dialogue entre un médecin formé à la consultation mémoire et le patient ou son entourage familial. Ce dosage paraît d’autant plus opportun si le patient est jeune et actif.
Les experts précisent qu’en l’absence d’anomalie objective au bilan neuropsychologique, il n’y a pas lieu de demander l’analyse des biomarqueurs dans la LCS (ce qui peut engendrer des surdiagnostics). Ainsi, dans l’état actuel des connaissances, le dépistage systématique en population générale de la maladie d’Alzheimer n’est pas indiqué.
Quant aux biomarqueurs plasmatiques de la maladie d’Alzheimer, ils n’ont actuellement pas de place validée dans le cadre du soin courant, que ce soit en soins primaires ou en consultation mémoire spécialisée.
Stades de la maladie d’Alzheimer
Troubles neurocognitifs mineurs liés à une maladie d’Alzheimer :
- Performances cognitives altérées/anormales sur la base de tests cognitifs objectifs et normés.
- Preuve de déclin par rapport au niveau de base.
- Capacité à effectuer les activités de la vie quotidienne de manière indépendante, mais les difficultés cognitives peuvent avoir un impact fonctionnel détectable sur les activités complexes de la vie quotidienne.
Troubles neurocognitifs majeurs avec altération fonctionnelle légère (stade léger) :
Déclin cognitif progressif et modification fonctionnelle légère dans les activités de la vie quotidienne (AVQ) instrumentales (préparation des repas, tâches ménagères, utilisation des moyens de transport, gestion administrative ou des finances, des traitements médicamenteux…) et indépendance dans les AVQ de base (toilette, habillage, transferts, prise des repas préparés).
Troubles neurocognitifs majeurs avec altération fonctionnelle modérée (stade modéré) :
Déclin cognitif progressif et modification fonctionnelle modérée dans les AVQ de base nécessitant une assistance.
Troubles neurocognitifs majeurs avec altération fonctionnelle sévère (stade sévère) :
Déclin cognitif progressif et modification fonctionnelle sévère avec dépendance pour les AVQ de base.
Boutitie L, Verny M. Repérage des troubles neurocognitifs en médecine générale.Rev Prat Med Gen 2024;38(1083):21-6.
Dans cet article
- Critères diagnostiques : stades de la maladie d’Alzheimer
- Que faire devant une plainte cognitive en MG ?
- Quels outils utiliser pour repérer un trouble neurocognitif en soins primaires ?
- En soins primaires, quel bilan paraclinique réaliser en première intention face à une suspicion de trouble neurocognitif ?
- Comment orienter un patient suspect de trouble neurocognitif ?
- Diagnostic précoce : enjeux et limites

 Encadrés
Encadrés