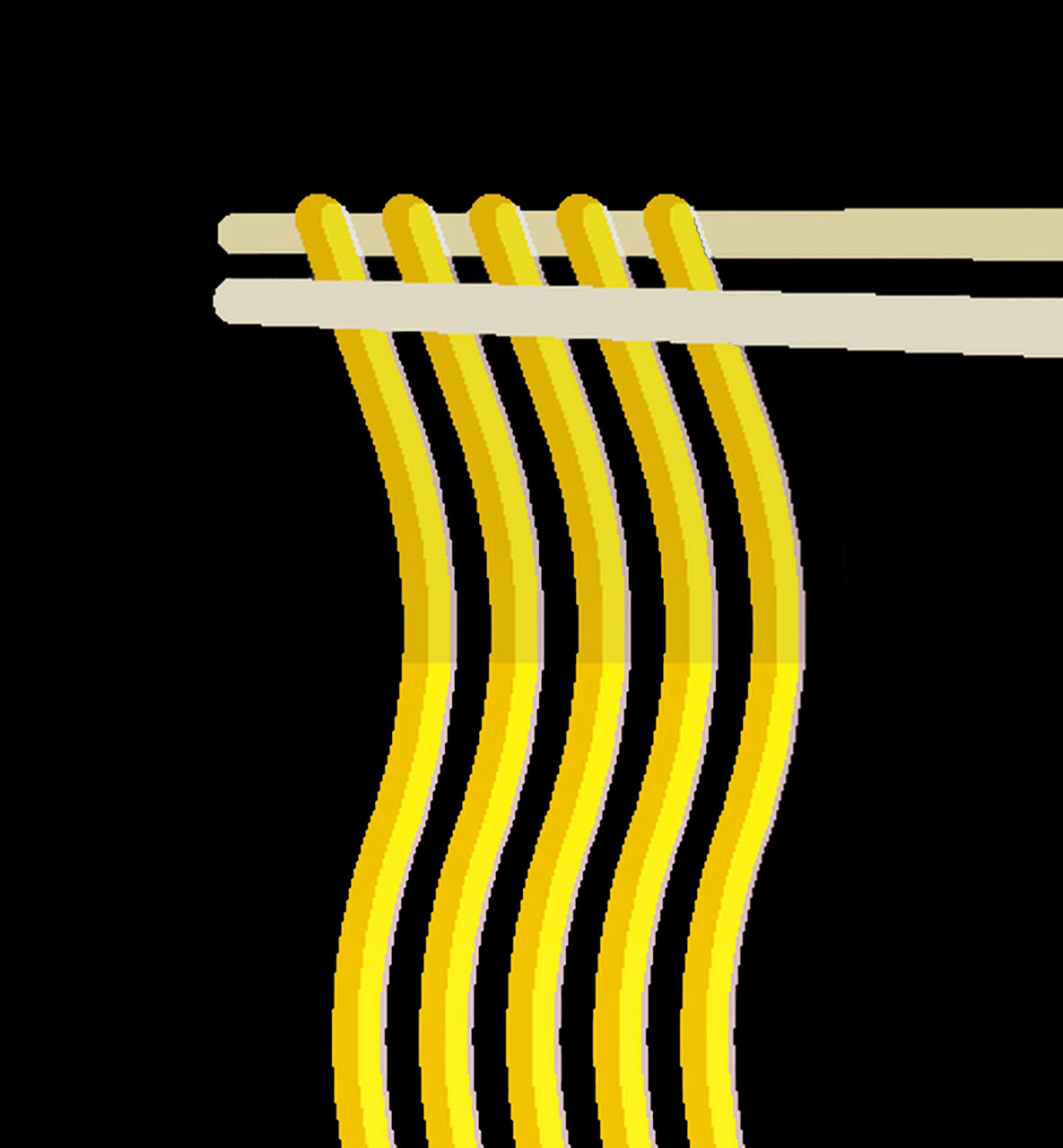Des maladies le plus souvent liées au voyage
Les parasitoses intestinales sont particulièrement fréquentes dans les pays à bas revenu ou faible indice de développement. En France, elles sont le plus souvent importées et présentes chez des voyageurs ou des migrants, mais certaines peuvent se retrouver sous nos latitudes (cf. ci-dessous).
Il existe deux grands types de parasites intestinaux : les helminthes (vers parasites) et les protozoaires (eucaryotes unicellulaires), responsables respectivement des helminthoses et des protozooses intestinales.
Quatre voies de contamination
Les parasitoses intestinales endémiques en France métropolitaine sont avant tout l’oxyurose (figure) et la giardiose et, dans une moindre mesure, le téniasis à Taenia saginata et l’ascaridiose, ainsi que l’amibiase. Enfin, l’anguillulose est d’importation dans l’Hexagone, mais reste autochtone en Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion.
On distingue quatre grandes modalités de contamination :
- le péril fécal (ou transmission féco-orale) : lié à un défaut d’hygiène, il est surtout rencontré en contexte de promiscuité, de pauvreté, d’absence de réseau fiable d’eau potable et de tout-à-l’égout ;
- la consommation d’aliments contaminés, en lien avec les normes d’hygiène de la production alimentaire, et aussi les coutumes culinaires (par exemple, appréciation de la viande crue ou peu cuite de bœuf (T. saginata) ou de porc (Taenia solium)) ;
- transcutanée, par la marche pieds nus et le contact avec de l’eau douce infectée ;
- la transmission directe entre individus (par exemple, propagation de l’oxyurose par ingestion ou inhalation d’œufs d’oxyures (Enterobius vermicularis), émis spontanément au niveau de la marge anale des personnes infectées).
Tableaux cliniques et diagnostic
Beaucoup de parasitoses intestinales sont le plus souvent asymptomatiques. Quand ils sont présents, les signes varient en fonction de l’organe touché, du sujet (enfant ou adulte, immunocompétent ou immunodéprimé), du parasite, du stade de l’infestation (phase d’invasion ou phase d’état). Ils sont généralement non spécifiques : hyperéosinophilie dans les helminthoses, douleurs abdominales, dyspepsie, diarrhée chronique, selles molles ou liquides (tableau 1). Quelques symptômes, comme le prurit anal dans l’oxyurose, orientent davantage le diagnostic.
Certaines maladies touchent majoritairement des populations à risque : par exemple, oxyurose chez l’enfant en collectivité et son entourage ; ascaridiose, amibiase et anguillulose chez des voyageurs et des migrants en provenance de régions tropicales.
Le diagnostic repose sur la mise en évidence du parasite dans les selles : œufs, larves, ou adulte (ascaris, oxyure, anneaux de ténia) pour les helminthes ; kystes, oocystes ou formes végétatives pour les protozoaires. Du fait d’une élimination irrégulière, plusieurs examens parasitologiques des selles (EPS) répartis sur plusieurs jours non consécutifs sont recommandés. La recherche de certains pathogènes nécessite des techniques particulières. Les signes évocateurs de chaque parasitose et les examens complémentaires à réaliser sont détaillés dans le tableau 1.
Prise en charge
Le traitement repose sur des antiparasitaires. Il comprend parfois le traitement de l’entourage, et inclut souvent le contrôle de l’éradication du parasite à distance de la prise du médicament, ainsi que le respect de normes d’hygiène renforcées (lavage des mains, entretien des ongles, passage du linge à 60 °C, etc.). Les protocoles de traitement pour chaque pathologie sont détaillés dans le tableau 2.
Pilly étudiant. Item 172. Parasitoses digestives : giardiose, amoebose, téniasis, ascaridiose, oxyurose cryptosporidiose et anguillulose. Infectiologie.com 19 avril 2023.
Vidal. Paraditoses. 23 janvier 2023.
Bouchaud O. Quand peut-on évoquer et comment traiter une parasitose intestinale en France ? Presse Med 2013;42(1);84-92.
Pour aller plus loin :
Draullette M, de Parades V. Oxyurose. Rev Prat Med Gen 2021;35(1058);303.
Fathallah N, Spindler L, de Parades V. Prurit anal. Rev Prat Med Gen 2020;34(1040);332-4.
Aouba A, Deshayes S. Principales causes parasitaires d’hyperéosinophilie. Rev Prat 2022;72(2);211-6.
Martin Agudelo L, Nobile C. Balades sur la plage : gare aux parasites ! Rev Prat (en ligne) 18 août 2022.