Vous êtes interne en cabinet de médecine générale.
Vous recevez Mme T. accompagnée de son fils de 10 ans, Sacha, pour des difficultés scolaires.
En effet, Sacha est en CM2 et la maîtresse rapporte des oublis fréquents de son matériel ou de ses devoirs, des difficultés à maintenir son attention et il est très sensible aux distracteurs qui le font souvent sursauter. Il a un comportement impulsif avec insolence envers les adultes ou les autres élèves, il rencontre des difficultés à gérer sa colère avec des crises très bruyantes sur des frustrations minimes. Les résultats scolaires en pâtissent.
Au domicile, il n’est pas rapporté de telles difficultés de comportement, mais une tendance à la dévalorisation et de nombreuses heures passées devant les écrans. L’alimentation se fait aisément, le sommeil est altéré avec des difficultés d’endormissement, des éveils nocturnes et des cauchemars. La mère rapporte des ronflements. Il refuse d’aller au football, prétextant être fatigué.
La grossesse s’est bien passée, il est né par césarienne à terme, sans souffrance néonatale. Le développement psychomoteur est sans particularité. Il a toujours eu tendance à faire des infections ORL type angine et otites à répétition. Dans les antécédents familiaux sont retrouvés des épisodes dépressifs caractérisés avec des addictions au premier degré et des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) avec trouble du comportement alimentaire au deuxième degré.
Sacha vit chez sa mère et va un weekend sur deux chez son père. Le mode de garde va bientôt être réévalué par le juge dans un contexte de violences éducatives et physiques par le père sur Sacha.
Vous recevez Mme T. accompagnée de son fils de 10 ans, Sacha, pour des difficultés scolaires.
En effet, Sacha est en CM2 et la maîtresse rapporte des oublis fréquents de son matériel ou de ses devoirs, des difficultés à maintenir son attention et il est très sensible aux distracteurs qui le font souvent sursauter. Il a un comportement impulsif avec insolence envers les adultes ou les autres élèves, il rencontre des difficultés à gérer sa colère avec des crises très bruyantes sur des frustrations minimes. Les résultats scolaires en pâtissent.
Au domicile, il n’est pas rapporté de telles difficultés de comportement, mais une tendance à la dévalorisation et de nombreuses heures passées devant les écrans. L’alimentation se fait aisément, le sommeil est altéré avec des difficultés d’endormissement, des éveils nocturnes et des cauchemars. La mère rapporte des ronflements. Il refuse d’aller au football, prétextant être fatigué.
La grossesse s’est bien passée, il est né par césarienne à terme, sans souffrance néonatale. Le développement psychomoteur est sans particularité. Il a toujours eu tendance à faire des infections ORL type angine et otites à répétition. Dans les antécédents familiaux sont retrouvés des épisodes dépressifs caractérisés avec des addictions au premier degré et des troubles obsessionnels compulsifs (TOC) avec trouble du comportement alimentaire au deuxième degré.
Sacha vit chez sa mère et va un weekend sur deux chez son père. Le mode de garde va bientôt être réévalué par le juge dans un contexte de violences éducatives et physiques par le père sur Sacha.
Question 1 - Vos hypothèses diagnostiques sont :
Probable au vu des symptômes d’inattention, d’hyperactivité et d’impulsivité décrits.
Possible activation neurovégétative avec reviviscences nocturnes dans un contexte d’événement potentiellement traumatique (suspicion de maltraitance par le père).
Possible avec retentissement diurne négatif (activités, fatigue, plainte cognitive, irritabilité et perturbation de l’humeur…).
Absence de difficulté avec la loi ou de conduites bafouant les droits fondamentaux d’autrui ou de transgression des normes sociales.
Possible clinique d’asthénie chronique avec inattention, agitation, impulsivité ou « TDAH-like » pouvant être la résultante d’un SAOS avec éveils nocturnes provoquées par les apnées.








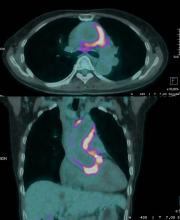
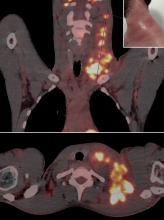
Il n’y a pas de différences majeures dans les critères diagnostiques du TSPT entre l’adulte et l’enfant. Pour autant, on retrouve des spécificités cliniques. Chez l’enfant et l’adolescent, les syndromes de répétition et d’évitement sont difficiles à identifier en raison des moindres capacités d’expression verbale et d’abstraction que chez l’adulte. Le syndrome de répétition est souvent caractérisé par la répétition de certains aspects de l’événement traumatique dans les jeux, les dessins et les cauchemars. Des comportements agressifs et impulsifs peuvent être au premier plan chez l’adolescent (cf. item 66 du Collège de psychiatrie).